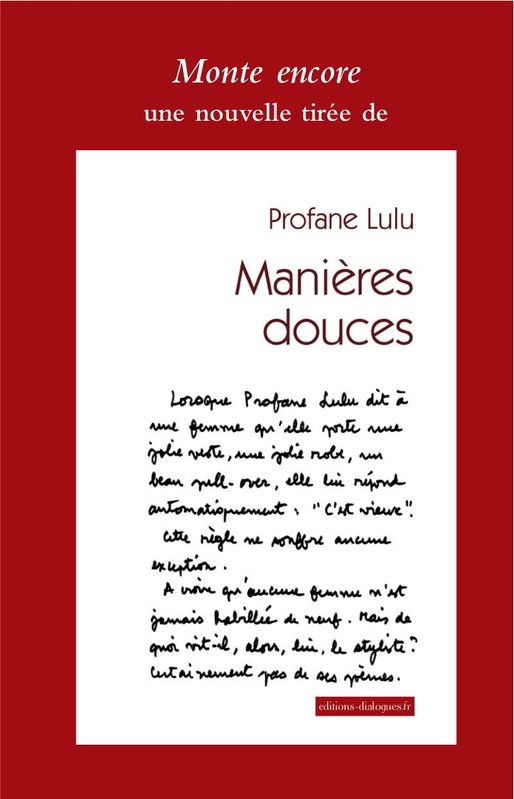Table des matières
Tu m’avais promis que tu serais enfin à moi ce jour-là qu’il suffisait d’un effort de patience. « Je t’aimerai au sommet de la solitude ». Je grelottais. Tu te tenais sur la place du village, dans la nuit noire, à l’écart du réverbère et j’avais de la peine à reconnaître ta fine silhouette dans ta tenue de bibendum, comme si tu avais entassé sur toi toute ta garde-robe de haute montagne, toute l’histoire de tes vieux habits. Tu tenais à la main une corde et un piolet. J’avais froid. « Marchons, me dis-tu. » et nous marchâmes sur le chemin de la nuit. Tu portais de fortes chaussures et je n’avais que de simples tennis. Très vite, concentrée sur ta marche, tu pris deux pas d’avance, puis trois, et je sus que j’aurais le plus grand mal à régler mon pas sur le tien.
La marche d’approche me parut interminable sur ce sentier qui devait serpenter dans les vignes et dont les silex aigus se plantaient dans mes semelles minces. J’avais froid, j’avais faim, j’avais soif et j’avais envie de toi qui marchais devant moi de ton pas de montagnarde, concentré et obstiné. J’avais rêvé d’une flânerie bavarde, entrecoupée de baisers, de préludes, tissée de désir, et je me retrouvais glacé dans une course en montagne dont je ne pouvais pas deviner le sommet.
Tu allais de ton pas et je devais courir par intermittence pour ne pas perdre ton ombre dans le noir de la nuit. Le sentier se mit à monter plus régulièrement et tu ôtas ta première veste que tu jetas sur le bord du chemin. Une seconde, j’eus la tentation de la ramasser et de te la tendre, la tentation de l’enfiler aussi tant le froid m’accompagnait encore, mais je renonçai car la régularité de ton pas me persuadait que tu avais fait ce geste délibérément.
Pendant un long moment, je respectai le silence de la nuit, comptant mes pas qui crissaient sur la pierraille du chemin, puis n’y tenant plus, je demandais une pause et ma voix sonna étrangement dans le silence noir du pied de la montagne. « Je t’aimerai au sommet de la solitude » me répondis-tu simplement et j’eus la certitude que cette phrase serait le refrain de mon jour. Je le répétais donc mentalement au rythme de mes pas qui ralentissait au fur et à mesure que la pente s’accentuait.
Il se mit à pleuvoir une eau sombre qui traçait son chemin dans mon cou. Tu jetas un anorak à la nuit. Je montais, tête baissée essayant de deviner mes pieds et les torrents que la pluie dessinait sur ma route. Ton tempo ne changea pas le moins du monde et je ressentis mes premières crampes. Nous montâmes ainsi fort longtemps. Je ne saurais dire combien, puisque tu m’avais interdit la montre au prétexte que le vrai plaisir n’a pas de durée et se moque des heures. Le froid, la fatigue et la pluie avaient depuis longtemps eu raison du calcul mental que j’avais essayé de faire depuis notre départ. Tu semas un pull, une écharpe et, bientôt, un premier ticheurte.
Alors que je venais pour la première fois de poser la main sur le rocher pour continuer ma progression, la pluie cessa et une lueur lointaine déchira la nuit. Quelque chose se faufilait entre les bancs de brume qui était peut-être l’espoir du jour. Bientôt je pus deviner la masse inquiétante de la montagne dont je gravissais le flanc. Tu jetas un carré de soie blanche qui tomba à mes pieds et ce fut le signal du jour.
Je pus enfin te voir et te reconnaître. Je reconnus ta silhouette fine et mon désir inscrit sur elle. Je reconnus tes épaules larges et tes cheveux liés en une queue qui battait ta nuque à chaque pas.
Tu t’arrêtas pour ôter ton pantalon imperméable et le jeter au fossé. Je fus soulagé de cet instant de répit, mais comme pour prévenir tout bavardage inutile, tu me dis simplement : « Je t’aimerai au sommet de la solitude. » Je reconnus tes jambes brunes que les grosses chaussures faisaient paraître plus minces encore. Le joli galbe de tes mollets, l’intimité ombreuse de ton creux poplité, la longueur de tes cuisses qui se perdaient dans un short trop vaste pour toi.
Nous traversions des étages de brumes dont la montagne était enrubannée, brumes blanches et glacées, brumes roses irisées, brumes d’arc-en-ciel, brumes illuminées de soleil, enfin. L’ascension devenait difficile, difficile pour moi, en tout cas, qui étais un homme de désir plus qu’un alpiniste. Toi, tu montais devant, des pieds et des mains. Tu jetas ton dernier ticheurte dans le vide qui s’accrocha comme un trophée à une vire. Il faisait chaud maintenant et j’avais peine à te suivre. Lorsque tu t’arrêtas un instant pour quitter ton soutien-gorge, tu me lanças la corde que je passai autour de ma taille. Et tu repris ta montée devant moi, m’offrant, en toute conscience, le spectacle du jeu des muscles de ton dos et de ton cou. Je me crevais les yeux dans le soleil pour ne rien perdre du spectacle et mon désir se faisait montagne et mes mains saisissaient les prises comme autant de caresses froides.
Le nez sur la paroi, je ne savais pas où nous en étions de notre progression. Lorsque tu t’arrêtas pour quitter ton short et ta culotte, je crus que nous n’étions plus très loin du sommet. En fait, il n’en était rien. Tu raccourcis la corde pour m’attirer plus près de toi et nous reprîmes notre ascension. J’étais presque à te toucher, mais tu avais choisi la juste longueur pour m’interdire de le faire. Je devinais tes seins qui ballaient au rythme de tes prises, et ce sont tes fesses que j’avais l’impression d’escalader désormais. À chaque ciseau de tes jambes, j’entrevoyais ta touffe et rien ne semblait devoir te ralentir. Nous grimpâmes ainsi pendant une bonne heure encore. J’avais glissé mon anorak dans mon sac à dos, ouvert mon col. Je cherchais mes prises dans les tiennes, regardant le jeu de tes gestes dessiner mon chemin.
Autour de nous, le paysage se déployait dans son vertige. Les sommets qui nous dominaient un peu plus tôt, se trouvaient maintenant au-dessous de nous, encore encapuchonnés de brumes. Les vallées étaient noires. Entre tes cuisses et par-dessus ton dos, je devinais l’arête sommitale qui traçait un trait de lumière et d’ombre en direction du ciel. Ta montée était régulière et lorsque, parfois, tu te retournais pour juger de ma progression ou m’assurer dans un passage difficile, ton air était grave et ton visage fermé.
Et puis vint enfin le moment où il n’y eut plus de montagne à gravir au-dessus de nous. D’une ultime poussée sur les bras, je te rejoignis sur un petit replat qui était notre sommet. Nous étions sur le toit de ton monde, au plus proche du soleil. L’univers autour de nous était de rochers et d’oubli. Ici, rien d’autre que nous ne vivait et ne désirait.
« Là, me dis-tu, quittant la corde qui nouait encore ta taille fine, nous sommes au sommet de la solitude et je suis à toi. »
Tu t’étendis sur la roche froide, bras et jambes largement écartés comme si tu voulais couvrir la plus grande surface possible de ce rocher désert. Tu étais là minuscule et splendide. Chez toi. Je voyais les lèvres roses de ton sexe s’ouvrir dans ta fourrure sombre, comme un premier sourire. Je devinais enfin la forme de ton désir. En un instant, je fus nu et m’approchai de toi, pour t’embrasser, te pénétrer, finir au fond de toi l’interminable voyage de l’amour. Tu fermais les yeux au soleil. Ton corps brillait de sueur et d’attente. J’avançai vers toi ma langue et mon sexe, sans hâte désormais, puisque tu étais à moi. Et je m’agenouillais, enfin entre tes jambes, au moment même où surgissait au-dessus de nous l’hélicoptère du secours en montagne et où la première cordée en contrebas agitait les bras et poussait les hauts cris triomphants, remontant vers nous le paquet abandonné de tes vieux habits.